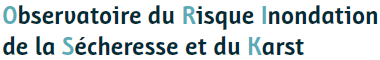Focus Inforisk - Le rôle des structures supra-GEMAPI : EPAGE et EPTB
Focus
Le rôle des structures supra-GEMAPI
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 attribue au bloc communal la compétence relative à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) dont les missions sont définies aux 1°, 2°, 5°, 8° du I de l'article L.211-7 du code de l'environnement.
Le risque d’inondation ou les atteintes à la qualité des milieux ne connaissant pas les frontières administratives, la réforme encourage le regroupement des communes ou des EPCI à fiscalité propre au sein de structures dédiées ayant les capacités techniques et financières suffisantes pour exercer ces compétences à la bonne échelle hydrographique, lorsque le bloc communal ne peut pas les assumer seul à l’échelle de son territoire:
-
Létablissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE) est un syndicat mixte en charge de la maîtrise d’ouvrage locale à l’échelle du sous-bassin versant. Il assure la maîtrise d’ouvrage opérationnelle locale pour la gestion du milieu et la prévention des inondations.
- L’établissement public territorial de bassin (EPTB) est un syndicat mixte établi à l’échelle d’un bassin ou d’un groupement de sous-bassins hydrographiques qui a pour mission de faciliter la prévention des inondations la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides. Il a notamment pour rôle d’apporter à ses membres l’appui technique nécessaire pour la réalisation des missions relevant de la GEMAPI et d’assurer la cohérence de l’activité de maîtrise d’ouvrage des (EPAGE)
L'équipe d'animation ORISK a interrogé certaines de ces structures en région Bourgogne-Franche-Comté :
- EPAGE Haut Doubs - Haute-Loue : M. Cyril Thevenet, directeur
- EPAGE du Loing : M. Matthieu Moes, directeur
- EPAGE de la Seille et affluents : Mme Sixtine Geffroy, chargée de mission GEMAPI
- EPTB Saône et Doubs : M. Cédric Borget, directeur par intérim et Mme Hélène Lambert, coordinatrice du SAGE Allan Savoureuse
Focus sur les EPAGEORISK : Quelles ont été les motivations du rassemblement des structures à l'échelle du bassin ?
Conscients de l’importance de cette thématique, renforcée par les aléas climatiques de ces dernières années, les élus des EPCI-FP ont souhaité démarrer une réflexion pour une organisation GEMAPI mutualisée et cohérente afin de mieux prendre en compte les enjeux du bassin. L’objectif était également de faciliter l’accès aux financements de l’Agence de l’Eau pour les années à venir.
Suite à cette inondation, le préfet coordonateur de bassin Seine-Normandie a commandé une mission d’inspection au CGEDD, dont les deux recommandations principales ont été la structuration d’un EPAGE sur le bassin et l’engagement d’une démarche PAPI. Suivant ces recommandations, le prefet coordonateur de bassin a missioné un préfet hors-cadre fin 2017 pour mener à bien la structuration en forme d’EPAGE.
Suites aux épisodes de fortes mortalités piscicoles connues sur la Loue en 2009/2010, le rapport du CGEDD missionné par la ministre de l’écologie propose la création d’un EPAGE pour disposer d’une structure reconnue disposant de moyens humains adaptés. La construction du syndicat mixte unique, proposée en 2015 par le Département, a fait l’objet d’un pilotage politique fort par le président de la CLE (VP du Département, président du SMMAHD), en collaboration avec le président du SMIX Loue.
Les 4 items de la GEMAPI sont exercés ainsi que la lutte contre la pollution, la mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’exploitation, entretien et aménagement des ouvrages hydrauliques propriétés de l’EPAGE, la valorisation touristique des milieux aquatiques, l'animation et la concertation dans les domaines des inondations, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l’élaboration, l’animation, la coordination et la mise en œuvre des documents d’objectifs de sites Natura 2000
Quel a été l’impact de la prise de compétence sur l'organisation et le dimensionnement des services ?
Les effectifs ont augmenté à hauteur de 3 ETP répartis entre la direction, le secrétariat/comptabilité et des postes de chargés de mission créés pour l’animation du SAGE et l’élaboration d’un contrat de bassin. Le volet prévention des inondations n’était pas vraiment assuré par les anciens syndicats: il est envisagé la création d’un poste en 2022. Quels sont les travaux prioritaires de l’EPAGE ?
Les ouvrages hydrauliques du bassin (vannages et clapets) sont gérés par les syndicats de rivière jusqu’à ce que l’EPAGE révise ses statuts en 2022 afin d’inclure l’item optionnel correspondant à leur gestion.
Le CTEC 2020-2024 affiche un programme de 20M€ sur la GEMA :
Le programme d’études préalable au PAPI du Loing compte 39 actions pour un coût total est de 2,2M€. L’EPAGE assure la maîtrise d’ouvrage de 8 d’entre elles. L’animation est assurée par l’EPTB Seine Grand Lac sur l’incitation du préfet; à l’issue du programme d’étude préalable, l’animation du PAPI sera reprise par l’EPAGE.
En tant qu’animateur Natura 2000, l’EPAGE assure également la maîtrise d’ouvrage d’action de restauration et gestion de milieux naturels et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les porteurs de contrats (communes, associations, privés). Partage d'expérienceAppel à contribution : avez-vous des besoins identifiés pour la suite des travaux ?
EBL : Nous aurions des besoins pour assurer l’AMO sur la partie érosion ruissellement, pour mettre en œuvre les mission du décret digues, et sur la préservation et restauration des ZEC et ZH, notamment les stratégies d’acquisition foncière
Respectivement, sur quels domaines pouvez-vous appuyer le réseau régional ?
ESA: Nous pouvons apporter notre expérience sur la conduite d’une étude GEMAPI pour la mise en place d’une structure de bassin.
Sur le volet GEMA nous avons de nombreux documents (CCTP études et travaux, DLE, DIG etc…). |
Focus sur les EPTBORISK : Quelle différence le label « EPTB » apporte-t-il par rapport à un EPAGE ou un Syndicat Mixte de Bassin ?
Cédric BORGET : Le label EPTB apporte surtout de la légitimité : l’EPTB Saône et Doubs, de par son label, est un acteur incontournable sur son territoire. Par exemple, il est sollicité pour avis pour le PGRI ou le SDAGE, et il est consulté sur les projets d’un certain montant impactant le cycle de l’eau sur son territoire et portés par d’autres acteurs. De plus, le label EPTB permet de bénéficier de certains outils administratifs que n’ont pas les simples syndicats mixtes de bassin, comme la délégation de la GEMAPI par les EPCI. Enfin, le label EPTB permet de porter un Projet d’Aménagement d’Intérêt Commun (PAIC), ce qui lui permet d’intervenir en-dehors du périmètre de ses membres. Par exemple, dans ce cadre, l’EPTB Saône et Doubs pourrait porter des travaux sur la Saône, même sur le territoire de collectivités non-adhérentes.
Comment l’EPTB exerce-t-il ses compétences de coordination de bassin versant sur son territoire ? Comment cette mission se met-elle en œuvre avec les collectivités GEMAPIennes ?
CB : Les missions de coordination sont confiées à l’EPTB Saône et Doubs par la loi à travers le Code de l’Environnement (L213-12, L566-10, R213-49). Celles-ci concernent surtout la coordination des syndicats de bassin versant, étant donné que ce sont eux qui exercent principalement la GEMAPI sur le territoire. Concrètement, l’EPTB Saône et Doubs exerce cette mission de 3 façons : la première est la mise en réseau des personnels des syndicats de bassin versant via le RGMA (Réseau des Gestionnaires de Milieux Aquatiques). La deuxième, plus informelle, est une mise en réseau politique et stratégique via les échanges entre élus et responsables de structures. Celui-ci vise à bien articuler les missions et à accorder les discours des différentes structures du bassin versant de la Saône et du Doubs envers les partenaires institutionnels et financiers comme l’Agence de l’Eau ou l’Etat. La dernière est plutôt technique : l’avis de l’EPTB est sollicité sur tout projet porté par un EPAGE et soumis à autorisation (R213-49 CE), pour tous les projets d’aménagement de bassin, d’entretien de cours d’eau et de défense contre les inondations dépassant 1,9M€ (R214-92 CE), lors de l’élaboration des SAGE (L212-3 CE), ainsi qu’en tant que Personne Publique Associée, aux projets de PAPI, SCOT, PLUI, Schémas Directeurs d’Assainissement, … Il apporte ainsi une vision d’ensemble et d’intégration à ces projets.
L’EPTB Saône et Doubs a-t-il des compétences hors-GEMAPI ? Si oui, pour lesquelles est-il le plus sollicité par ses adhérents ? Comment travaille-t-il sur la culture du risque inondation ?
CB : L’EPTB Saône et Doubs exerce bien des compétences hors-GEMAPI, notamment pour le compte de ses adhérents « non-GEMAPIens » (Départements et Régions). Dans le cadre de ses futurs statuts, elles consistent en l’animation d’observatoires, les missions de coordination, le portage d’études générales, l’animation des politiques publiques (Contrats de Rivière, SAGE, PAPI, Natura 2000). Le besoin le plus important pour les adhérents est l’animation des politiques publiques, car c’est ce qui ouvre la porte aux subventions pour leurs projets. Toutefois, le besoin le plus exprimé par une majorité de nos adhérents (surtout les Communautés de Communes, aujourd’hui majoritaires) est la réalisation d’opérations concrètes sur les axes, liées à la GEMAPI. Concernant la culture du risque, l’outil principal de l’EPTB Saône et Doubs est l’ORISK : c’est à la fois son support de travail et de communication. De plus, via les PAPI, l’EPTB Saône et Doubs porte systématiquement les actions de sensibilisation et de culture du risque, comme la pose de repères de crue, l’animation pour les scolaires, des circuits découverte, les opérations fil bleu, l’assistance aux communes à la réalisation de PCS et de DICRIM… Nous aimerions aussi développer les formations destinées aux élus, telles que celles organisées en juin 2015 dans le cadre du PAPI de Besançon. Enfin, l’EPTB Saône et Doubs attache beaucoup d’importance à la mise en valeur de données historiques via l’ORISK ; nous le considérons comme une base aux politiques de prévention.
Quelle est la place du SAGE dans la mise en œuvre de la GEMAPI ?
Hélène LAMBERT : Un SAGE est une démarche visant à instaurer une gestion équilibrée de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle d’un bassin versant. Il fixe des orientations et des objectifs pour répondre aux enjeux spécifiques au territoire, et soutenir l’objectif de reconquête du bon état des eaux visé par la Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) de 2000. Un SAGE peut ainsi mettre l’accent sur la préservation ou la restauration des milieux aquatiques et leurs annexes, ou, comme c’est le cas sur l’Allan, sur la prévention et la gestion du risque d’inondation. Les deux axes GEMA et PI peuvent d’ailleurs être étroitement liés, la restauration de la dynamique d’un cours d’eau ou de zones d’expansion des crues pouvant contribuer à un objectif de réduction de l’aléa à l’aval de la zone restaurée. Les orientations proposées par le SAGE sont ensuite déclinées par chaque autorité en charge de la GEMAPI ; l’instance de concertation du SAGE, la Commission Locale de l’Eau (CLE) veillant à la bonne cohérence des projets portés par les différents opérateurs.
Le SAGE Allan/Savoureuse prévoit-il des actions hors-GEMAPI, notamment dans la culture du risque ? Comment cela s’articule-t-il avec les collectivités GEMAPIennes ?
HL : Le SAGE Allan, approuvé en 2019, identifie cinq enjeux majeurs : la gouvernance et l’organisation des compétences, la gestion quantitative, la qualité de l’eau, la prévention et la gestion du risque inondation, et la restauration des milieux. La compétence GEMAPI relève essentiellement de ces deux derniers enjeux. Plus spécifiquement sur l’enjeu inondation, outre la réduction de la vulnérabilité, les dispositions du SAGE incitent entre autres à une meilleure préparation à la survenance d’un événement. Il s’agit par exemple de s’assurer que les communes, entreprises ou autres établissements vulnérables aux inondations disposent de procédures leur permettant de s’organiser pendant la crise, et de gérer la reprise de l’activité. Le SAGE recommande également d’entretenir la culture du risque via des informations à la population et aux entreprises. La mémoire des événements passés est notamment gardée par la pose de repères de crues. La mise en œuvre du SAGE Allan s’appuie sur deux dispositifs contractuels : un contrat de bassin (en cours d’élaboration) et un PAPI (en réflexion). Tous deux permettent aux maîtres d’ouvrage de bénéficier de financements privilégiés. La Commission Locale de l’Eau joue un rôle essentiel, c’est le moteur du SAGE : elle mène les réflexions, conduit les débats et oriente les décisions. La CLE est constituée de représentants des usagers, des services de l’Etat et d’élus locaux, ces derniers tenant une place prépondérante. La composition de la CLE du SAGE Allan a été récemment renouvelée, afin que les collectivités GEMAPIennes du bassin y soient toutes représentées.
Pour aller plus loin :L'interview intégrale des EPAGE, intégrant les questions relatives aux instances de gouvernance, à la taxe GEMAPI, aux outils fonciers mobilisés est à retrouver sur ORISK
Ressources sur la GEMAPI et en particulier sur les systèmes d'endiguement sur la page ORISK dédiée
Les EPAGE interrogés :
|